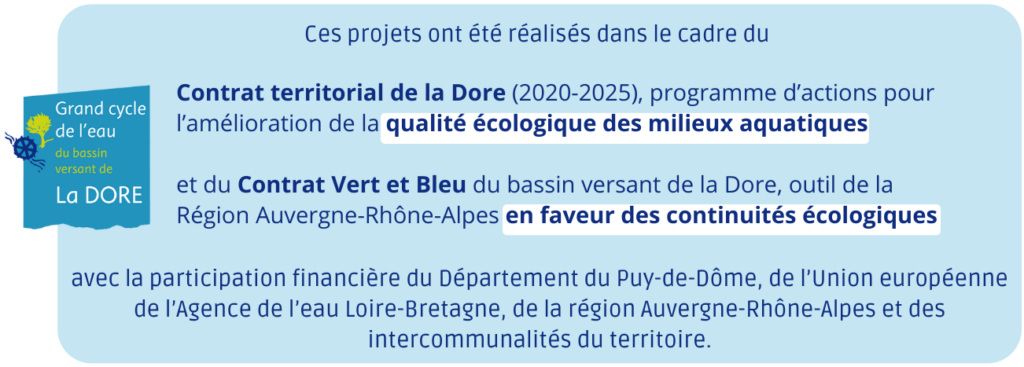Les zones humides, véritable richesse naturelle, jouent un rôle crucial et méritent toute notre attention. Découvrez un aperçu des actions mises en œuvre par le Parc, en lien avec les acteurs de la forêt, pour les restaurer et valoriser localement leurs atouts face aux défis climatiques actuels.
Mots-clés : Zones humides, restauration
Stockage de l’eau, puits de carbone, zones tampons atténuant les crues et améliorant la qualité de l’eau, réservoir de vie d’une incroyable diversité : les zones humides offrent une multitude de services essentiels qui en font une ressource naturelle et un enjeu patrimonial majeur sur notre territoire. À travers un projet de restauration réalisé sur les sources du cours d’eau du Miodet, découvrez l’action du Parc en faveur de ces milieux.
Un contexte sylvicole caractéristique du territoire
Dans un contexte de déprise agricole, couplé à une volonté de l’État de redynamiser la filière bois, le Livradois a fait l’objet d’une intensification de la sylviculture autour des années 1970. De nombreux secteurs ont ainsi fait l’objet d’une plantation massive, majoritairement d’épicéas
En moyenne montagne, où de nombreux cours d’eau prennent naissance, ce phénomène a eu un impact dévastateur sur les milieux humides.
Pour favoriser le développement des jeunes plants, la réalisation de fossés drainants était monnaie courante. Ainsi, d’anciennes prairies humides ou des boisements tourbeux ont été fortement impactés et portent aujourd’hui les stigmates de ces pratiques.
Une évolution des pratiques vers une synergie bénéfique à tous
Le complexe humide des sources Miodet illustre bien ce contexte. Situé sur la commune de Saint-Eloy-la-Glacière et couvrant 70 ha, il est constitué de multiples milieux humides, dont certains sont fortement impactés par les pratiques en place.
Sur sa partie amont, se trouve une parcelle sectionale appartenant à la commune de Saint-Eloy-la-Glacière. Soumise au régime forestier, elle avait déjà retenu l’attention des agents de l’Office National des Forêts (ONF). Un travail de cartographie du réseau des fossés drainants, ainsi que la caractérisation des secteurs humides, a permis d’alimenter les échanges entre le Syndicat mixte du Parc Livradois-Forez et l’ONF.
La nécessité d’intervenir sur ce secteur pour rétablir le bon fonctionnement des milieux humides, tout en poursuivant une activité sylvicole, était une évidence.


La phase de travaux
Avec l’accord de la commune, plusieurs chantiers ont été réalisés entre 2023 et 2024. Ces interventions se sont articulées avec l’itinéraire de gestion sylvicole mené par l’ONF. Ces travaux ont consisté en une réouverture des secteurs humides par le biais d’un abattage sélectif et une neutralisation des fonctions drainantes.Ces abattages ciblés permettent à la fois de conserver de l’ombrage et une ambiance forestière fraîche et humide, limitant l’évapotranspiration et évitant une remise en lumière trop brutale. Différentes solutions techniques ont été employées pour tenir compte de la sensibilité du milieu.
L’abattage manuel et le débardage depuis des zones portantes ont été privilégiés. Cette méthode a permis de réaliser l’ébranchage des arbres en dehors de la zone humide. Ne pas laisser les « déchets » de la coupe sur l’emprise humide est un paramètre important pour favoriser le retour d’une végétation pionnière de ce type de milieu.
L’équipe spécialisée de travaux en rivière du parc s’est chargée de la réalisation de « bouchons », visant à supprimer le drainage de la zone. Ce sont 7 mares en cascade qui ont été réalisées. Vouées à se combler naturellement, elles participent néanmoins à la diversification du site et évolueront naturellement vers un autre type d’habitat.


Un suivi pour appuyer la démarche
Il est indispensable d’avoir une vision de la plus-value apportée par ce type de travaux. La mise en place de suivis écologiques permet d’apprécier l’évolution de l’ensemble du secteur. Il s’agit ici d’observer la flore. Selon l’humidité du sol dans le temps, la végétation n’est pas la même.
Des relevés localisés sont réalisés avant les travaux. Cet état de référence permet une comparaison dans le temps par la reconduction de ces mêmes relevés.
Ces précieuses informations sont cruciales en vue de reproduire et d’optimiser ce type d’interventions.
Et sur le reste du complexe humide ?
À l’échelle de l’ensemble du site, ce sont au total trois autres projets qui ont été mis en œuvre. Avec l’objectif commun d’améliorer la fonction de stockage de l’eau et sa restitution au cours d’eau tout au long de l’année, 3 ha ont ainsi pu retrouver un caractère naturel.
L’ensemble de ces projets a vu le jour grâce aux opportunités et à un travail d’animation de longue haleine. La problématique du morcellement parcellaire et l’enjeu financier lié à la sylviculture complexifient la tâche. Aujourd’hui, d’autres secteurs au sein du complexe sont ciblés et pourraient faire l’objet d’actions de restauration dans le futur.
Valoriser ces actions pour une prise de conscience collective
Le 26 février, les ambassadeurs nature du Parc ont participé à une animation organisée par le Parc dans le cadre de la journée mondiale des zones humides.
Le projet du complexe humide des sources du Miodet a servi de support pour échanger sur le sujet de la restauration des milieux humides, de la gestion forestière et des bénéfices partagés par ces milieux.
Il est important de pouvoir faire évoluer la perception de ces milieux, autrefois souvent perçus comme une contrainte. Concilier les usages favorise un écosystème plus résilient. Ces actions collectives sont l’occasion de le mettre en avant et sont vecteurs de la diffusion de l’information au sein du territoire.